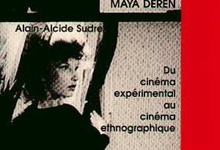Lettre à Alain-Alcide Sudre (1940-2025) par yann beauvais
Alain, tu nous as quittés cette fois-ci pour de bon. Ta disparition marque la fin d’une époque qui avait vu depuis la fin des années 70, début des années 80 l’éclosion de nouvelles générations de cinéastes avec lesquels tu as fréquemment entamé des dialogues fructueux, autant pour ton travail critique que pour les cinéastes.
Avec Rose Lowder, vous avez entrepris de montrer des films en Avignon, à la fin des années 70 avec comme projet initial la possibilité que les cinéastes puissent se rencontrer et discuter non seulement de leurs travaux mais aussi de la spécificité de la scène du cinéma expérimental. Tu ne découvres le cinéma expérimental qu’en 1975, après avoir été critique de cinéma dans un journal d’étudiants catholiques1. Lors de l’été 77, vous avez invité le Collectif Jeune Cinéma puis la Coopérative des cinéastes à présenter tous leurs films en Avignon, alors qu’en 1979 vous organisez un colloque « Cinéma des années 80 aux années 20 » avec la Paris Film Coop. Ces manifestations étaient organisées par le Préa (Pratique, recherches et études artistiques), qui donnera naissance plus tard aux Archives du film expérimental d’Avignon, et ont rendu possible la création d’une structure qui ne se limitait pas à collectionner des films, ce qui était pour le moins nouveau à l’époque, en dehors d’un cadre institutionnel incarné par les cinémathèques ou musées d’art contemporain, mais aussi à les montrer, et surtout constituer, pour reprendre tes termes, un instrument de recherche et non une simple cinémathèque, notre politique d’acquisition des films se distinguant en cela de bon nombre d’équivalents étrangers. En effet, quand il existe des initiatives semblables à la nôtre, venues pour beaucoup plus tardivement, celle-ci se contentent le plus souvent de collecter les films (et les vidéos), mais ce, sans lier cette activité à l’archivage des documents sur papier qui, touchant à la même pratique, intéresse d’éventuels chercheurs en ce domaine2.
C’est toi qui as véritablement impulsé cette idée de collection, et qui a fait les premières démarches pour changer le Préa en une autre structure qui pourrait devenir l’une des premières collections de films expérimentaux en province et gérée par une cinéaste et un théoricien. Ces démarches en vue de fonder cet espace tu les menais à côté de l’enseignement que tu donnais, mais aussi en te consacrant non seulement à l’écriture mais à la traduction de nombreux textes de cinéastes britanniques dans un premier temps, puis américains par la suite, afin de rendre accessible des textes fondamentaux auxquels les nombreux cinéastes français et/ou le public intéressé en France n’avaient pas accès car ne parlant pas l’anglais, n’as-tu pas été ainsi un des deux traducteurs de A Perspective on English Avant-Garde Film (1978) qui dressait un panorama du cinéma expérimental britannique des années 60 et 70 qui avaient été riches en œuvres autant qu’en avancées théoriques et qui se caractérisaient par une remise en cause de la perception et/ou conception américaine du cinéma d’avant-garde. Ainsi, plus que dans le film structurel américain, le cinéma britannique insiste sur la réflexivité d’une démarche dans laquelle le récepteur ne peut rester dans l’attitude d’admiration passive propre à la catharsis. Pour ce faire, dans ses films, dont Room Film 1973 (1973), Gidal privilégie les images au seuil de l’identifiable, sans donner au spectateur la possibilité de se repérer dans un espace circonscrit.3 L’importance de ce travail n’a pas été reconnue à sa juste valeur tout comme tes écrits critiques sur les mouvements du cinéma expérimental.
Lorsque nous avons fondé Light Cone, tu as avec Rose appuyé l’irruption de cette nouvelle coopérative en nous proposant souvent des écrits que nous avons publié dans la revue Scratch, mais avant cela, tu as sans doute été l’une des premières personnes qui m’aient poussé à écrire, en acceptant d’être un lecteur attentif et critique de mes premiers textes, qui nécessitaient plus qu’un accompagnement stylistique. Par le biais des archives, tu as organisé une série de rencontres et d’interviews de cinéastes qui leur ont permis d’éclairer leurs travaux, je pense ici principalement à cette interview de Jakobois, ou de Vivian Ostrovsky. On ne pourrait pas tous les citer car tu t’es intéressé de manière constante aux cinéastes français pensant que leurs travaux n’avaient pas reçu suffisamment d’attention à l’international. Tu y voyais là comme une injustice à réparer, qui allait de pair avec les dénonciations quant à la trop fréquente exclusion de Rose Lowder des programmes.
Ton travail s’est donc articulé selon la volonté de rétablir, ou plus exactement de faire reconnaître la spécificité des recherches cinématographiques des uns et des autres, qu’ils s’agissent du cinéma britannique, canadien ou de figures plus proches, Rose Lowder, moi-même, Jakobois (Novembre 844)… Cette lutte incessante pour rétablir les choses pouvait paraître tenace, mais elle était toujours accompagnée d’humour. Je me souviens qu’à l’occasion d’une réponse à un article de Dominique Noguez sur le cinéma expérimental, la figure du vilain petit canard noir avait été tourné en dérision5. Ne définissais-tu pas le cinéma expérimental comme un ensemble de pratiques exploratoires qui nécessite l’élaboration d’une pensée filmique autonome6 ?
L’approche sociologique de la pratique du cinéma expérimental s’accompagne pour toi d’une étude théorique quant à ce même cinéma, qu’il s’agisse des avant-gardes des années 20 ou 30, du cinéma matérialiste britannique ou bien encore de ce qui différencie le travail théorique et cinématographique de Rose Lowder. En effet comme tu le faisais remarquer dans une interview7, j’ai privilégié la critique à la théorie du cinéma, alors que pour toi c’est celle-ci qui semblait nécessaire afin de se positionner non seulement dans l’histoire du cinéma mais surtout afin de marquer les différences et spécificités des pratiques de chaque cinéaste. À cet égard, ton engagement vis-à-vis du travail de Rose Lowder, ta compagne, est exemplaire puisqu’il a consisté à inscrire à travers différents articles la singularité de son travail, pas seulement dans les techniques déployés pour chacun de ses films, mais aussi pour insister sur la singularité de son engagement dans le champ écologique, je pense par exemple à cet article « Le film expérimental : un autre regard sur l’histoire »8, mais on pourrait en citer bien d’autres dans lesquels tu défends avec talent ce travail.
Avec la soutenance de ta thèse « Dialogues théoriques avec Maya Deren : du cinéma expérimental au cinéma ethnologique »9, on espérait que tu obtiendrais un poste d'enseignant dans une université française, mais c’était sans compter sur le système de caste de l’université française et il fallut attendre quelque temps avant que tu ne sois nommé à l’université Paul Valery de Montpellier. Dommage que cela n’est pu être plus tôt car ton enseignement aurait rendu possibles d’autres approches que celles que l’on trouvera par la suite et qui font du cinéma expérimental une spécialisation de plus.
La publication de cet ouvrage est arrivée trop tard, la thèse avait été soutenue en 1991, et permettaient de découvrir en français de nombreux textes et recherches de la cinéaste et rendait accessible de nombreuses traductions de textes critiques en provenance de l’ouvrage publié par les Anthology Film Archives : The Legend of Maya Deren. Cette thèse permettait de comprendre les enjeux relatifs à la pensée de Maya Deren et ce non seulement en relation avec le cinéma d’avant-garde mais aussi en tant qu’artiste femme devant créer l’espace à partir duquel elle puisse être reconnue. Ce double mouvement qui inclut l’expression et la diffusion de ses films autant que de sa pensée est ce qui permet de comprendre comment elle passera de l’engagement politique au radicalisme artistique avant de se convertir en artiste-magicienne. La singularité de la démarche, l’ampleur des changements auxquels procède la cinéaste n’est pas sans anticiper bien que différemment le travail de Rose Lowder : Si Rose Lowder, dans le champ des recherches visuelles auquel elle s’intéresse, conçoit ses films comme des instruments d’investigation, activité cognitive et heuristique ayant l’art pour fin et comme moyen, Maya Deren conçoit les siens d’une façon certes conceptuelle, mais elle y voit une création qui, comme telle, maintient des liens privilégiés avec l’imaginaire et la sensibilité (la conscience affective de Ferdinand Alquié) aboutissant au caractère quasi-religieux du film rituel10.
Avec Rose, vous avez toujours apporté votre soutien aux différents projets que nous avons pu initier, qu’il s’agisse de programmations thématiques tel Musique film, ou bien Mot : dites, images11, pour lesquels votre apport a été essentiel et ce principalement pour la publication du catalogue Mot : dites, images. Pour ce catalogue tu avais non seulement écrit un texte, « L’écriture comme matériau filmique », mais tu avais aussi supervisé et révisé les textes, autant que traduis le texte de Scott McDonald, à un moment où je décrochais suite au décès de mon père survenu lors de l’élaboration de la programmation et l’écriture du catalogue. Apport important et qui faisait écho à tes contributions dans le cadre de Musique film12 où le nombre de traductions de textes de cinéastes américains et allemands fut essentiel.
J’aimerais pour finir évoquer d’autres traits de ton caractère qui ont moins à voir avec le cinéma qu’avec une certaine convivialité ; je ne peux m’empêcher de me souvenir de ta gourmandise et du plaisir que tu avais à dévorer des desserts, mais pas uniquement, et ceux-ci quand bien même il fallait à partir d’un certain moment faire plus attention à ta santé. Mais nos rencontres moins fréquentes ces dernières années, vu mon éloignement au Brésil, quand elles avaient lieu dans des restaurants ne pouvaient pas se terminer sans l’essai d’un dessert que tu connaissais déjà ou voulais essayer.
Il restera toujours un regret qui j’espère sera comblé lorsque sera réuni un ensemble de tes textes des années 80 et 90, trop souvent disséminés dans des revues ou catalogues épars. En effet, la manière dont tu abordais la pratique du cinéma expérimental se singularise par rapport à la critique française de ces années-là. Elle était nourrie d’une très grande connaissance des enjeux théoriques de ces pratiques et mériterait d’être accessible. Dans tous les cas, merci Alain pour ce que tu as fait, pour nous tous.
yann beauvais
Recife, avril 2025
1. William English, « Three aspects of French Experimental Films: Interview with yann beauvais, Rose Lowder and Alain Alcide Sudre », in Millenium Film Journal N° 22-23, New York hiver 1990-91, p. 113.
2. Alain Alcide Sudre, « 1976-2002. De Préa aux Afea : Inventaire chronographique de 25 ans de programmation et d’archivage pour la défense du film comme art visuel », in L’image en mouvement, 25 ans d’activité pour la défense du cinéma comme art visuel, Afea, Avignon 2002.
3. Alain Alcide Sudre, « Structurel (Film) », in Alain et Odette Virmaux (dir.), Dictionnaire du cinéma mondial : mouvements, écoles, courants, tendances et genres, Éditions du Rocher, Monaco, 1994, p. 340.
4. Publié dans Scratch Revue n° 6, janvier 1985.
5. Voir « le Nouveau Roman de Canard, à propos de Le cinéma expérimental de Dominique Noguez » dans Le cinéma sous la direction de Claude Beylie et Philippe Carcassonne, Scratch Revue n° 4/5, Paris avril 1984, pp. 113-117.
6. Alain Alcide Sudre, « Pour une pratique exploratoire » in La part du visuel : films expérimentaux canadiens, Avignon 1991, p. 56.
7. « Le cinéma décadré », yann beauvais, sous la direction de Yung hao Liu, Y2K Reforme What, Tresor Co & Chinkel-Graff Co, Taipei 1999, p. 51.
8. In Vertigo n°16, « Face à l’histoire », Jean Michel Place, Paris 1997, pp. 171-179.
9. Publié chez l’Harmattan, collection Champs Visuels, Paris 1996.
10. Alain-Alcide Sudre, Dialogues théoriques avec Maya Deren, L’Harmattan, Paris 1996, p. 241.
11. Mot : dites Images, sous la direction de yann beauvais et Miles McKane, Scratch / Centre Georges Pompidou, Paris 1988.
12. Musique film, sous la direction de yann beauvais et Deke Dusinberre, Scratch / La Cinémathèque française, Paris 1986.